Le fléau des sargasses : le revers écologique d’un phénomène mondial en expansion
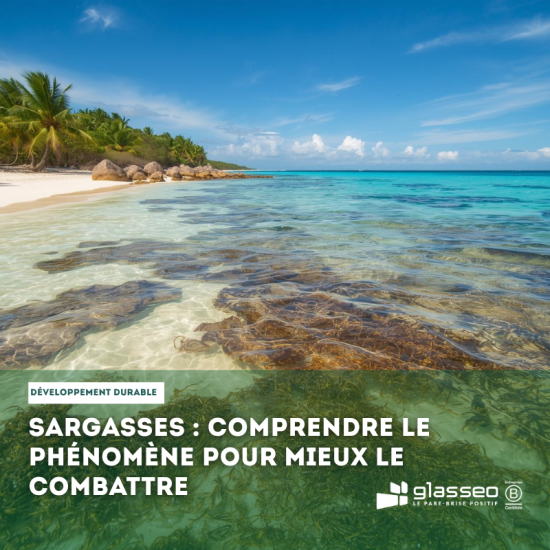
Sargasses : comprendre le phénomène pour mieux le combattre
Lors de la dernière Route du Rhum, en 2022, nous avons eu la chance de rencontrer Nathalie LOL, directrice de GWADAIR, l’agence de surveillance de la qualité de l’air à Pointe-à-Pitre. C’est elle qui, la première, nous a alertés sur le danger des sargasses.
C’était il y a plus de quatre ans, et les choses ne se sont pas arrangées depuis. On vous explique pourquoi :Depuis plus de dix ans, les sargasses ont pris leurs quartiers d’été dans les Caraïbes. Ces algues brunes flottantes, venues du large, s’échouent massivement sur les côtes de Guadeloupe, Martinique, Guyane ou encore Saint-Martin.
Leur arrivée est désormais prévisible, mais leur ampleur ne cesse d’inquiéter. À tel point que les autorités françaises parlent aujourd’hui de catastrophe écologique récurrente.
Pour comprendre le phénomène, il faut lever les yeux vers l’océan Atlantique : tout commence au cœur d’une zone appelée la mer des Sargasses, au nord des Antilles. Ce vaste gyre océanique — une sorte de tourbillon géant de courants marins — abrite depuis toujours ces algues flottantes, sans racines ni attaches.
Mais ce qui était jadis un écosystème stable est devenu, en quelques années, une véritable machine à proliférer.
Les origines du désastre : quand l’homme dérègle l’équilibre marin
La prolifération des sargasses est un symptôme du dérèglement planétaire. Plusieurs facteurs s’additionnent et forment un cocktail explosif :
- L’eutrophisation des eaux : les engrais agricoles riches en azote et en phosphore, charriés par les fleuves d’Amérique du Sud (notamment l’Amazone et l’Orénoque), nourrissent les algues comme un buffet à volonté.
- Le réchauffement des océans : une eau plus chaude accélère la croissance des sargasses.
- La déforestation et les ruissellements agricoles : en supprimant les zones tampons naturelles, on laisse filer les nutriments directement vers la mer.
- Les courants marins modifiés : certains chercheurs pointent aussi le changement des courants atlantiques, favorisant l’arrivée massive d’algues vers les Caraïbes.
Résultat : le “Great Atlantic Sargassum Belt”, un gigantesque ruban d’algues de près de 8 000 kilomètres de long, visible depuis l’espace, traverse chaque année l’Atlantique.
D’après la NASA, la biomasse totale de sargasses en 2023 atteignait plus de 13 millions de tonnes, un record historique.Une menace majeure pour les DOM-TOM
En Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, les échouages massifs ne sont pas seulement un problème d’image ou de tourisme. Ils sont devenus un enjeu de santé publique, économique et social.
Lorsqu’elles s’échouent, les sargasses s’entassent sur les plages et pourrissent en quelques jours. Cette décomposition dégage des gaz toxiques, notamment du sulfure d’hydrogène (H₂S) et de l’ammoniac.
L’exposition à ces gaz provoque des irritations des yeux, des maux de tête, des nausées, voire des troubles respiratoires sévères. Plus de 11 000 consultations médicales liées aux sargasses ont été recensées en Guadeloupe et en Martinique depuis 2018 (source : Santé publique France).
Certains habitants ont même dû évacuer leur domicile lorsque la concentration de H₂S dépassait le seuil de danger.Pour les écosystèmes côtiers, le constat est tout aussi alarmant :
- Les sargasses étouffent les herbiers et les coraux ;
- Elles privent la faune marine d’oxygène ;
- Elles bloquent les moteurs des bateaux et bouchent les filets des pêcheurs.
Bref, c’est tout un pan de la biodiversité tropicale qui suffoque.
Des conséquences économiques lourdes
Les dégâts sont chiffrables.
Selon la Banque mondiale, les sargasses coûtent plus de 120 millions d’euros par an aux Caraïbes. En Guadeloupe, la seule gestion des échouages (ramassage, stockage, traitement) représente jusqu’à 10 millions d’euros par an.Les hôtels doivent fermer temporairement, les pêcheurs perdent leurs revenus, et les habitants vivent fenêtres closes.
L’impact est catastrophique aussi pour le tourisme : rebutés par l’odeur et les plages envahies, les visiteurs préfèrent changer de destination.Peut-on transformer le fléau en ressource ?
Face à l’ampleur du phénomène, chercheurs et entrepreneurs cherchent des solutions.
Des projets expérimentaux visent à valoriser les sargasses :- Production de biogaz ;
- Transformation en engrais ;
- Fabrication de matériaux biosourcés.
Mais ces tentatives se heurtent à la toxicité de l’algue : les sargasses contiennent parfois des métaux lourds (arsenic, cadmium), qui rendent leur exploitation risquée.
Une filière durable suppose donc un traitement préalable coûteux et complexe.
Pour l’instant, seule une minorité de ces projets ont dépassé le stade du prototype industriel.Les habitants en première ligne
En Guadeloupe, les habitants de Capesterre ou de Marie-Galante vivent au rythme des alertes.
Quand les vents changent de direction, il faut fermer les fenêtres, quitter les maisons ou déplacer les écoles.
Les associations locales dénoncent un sentiment d’abandon, estimant que la réponse publique reste insuffisante face à une menace connue et prévisible.Le gouvernement français a bien lancé un plan national Sargasses en 2022, doté de 36 millions d’euros sur trois ans.
Mais sur le terrain, les collectivités doivent encore improviser, faute de moyens suffisants et de solutions techniques efficaces. Les engins de ramassage sont peu nombreux et les zones d’entreposage manquent.Et GLASSEO dans tout ça ?
Chez GLASSEO, on s’intéresse de près à ces sujets environnementaux, car ils rappellent une vérité simple : tout est lié.
Les sargasses ne sont pas un problème “lointain” réservé aux tropiques. Elles sont la conséquence directe de nos modes de consommation, d’agriculture et de transport.Quand on agit, même modestement — comme lorsque nous réduisons notre empreinte carbone ou recyclons un pare-brise — on agit aussi, à notre échelle, pour que la planète respire un peu mieux.
Les conférences GLASSEO sur la protection des océans et l’économie circulaire le rappellent souvent : “Ce que nous faisons ici a un impact là-bas.” Les sargasses en sont l’exemple parfait.
En conclusion : un signal d’alarme planétaire
Les sargasses ne sont pas une simple nuisance tropicale. Elles sont un signal d’alarme global, une preuve que les équilibres marins sont fragiles et que la planète réagit déjà à nos excès.
Face à ce défi, la solution ne viendra pas d’un produit miracle, mais d’une action à la source : moins de pollution agricole, moins de rejets dans les fleuves, et une vraie coopération entre États riverains de l’Atlantique.
Car si l’océan est malade, nous le serons aussi.