CO₂ : du déclaré au constaté, quand un satellite vient vérifier nos promesses.
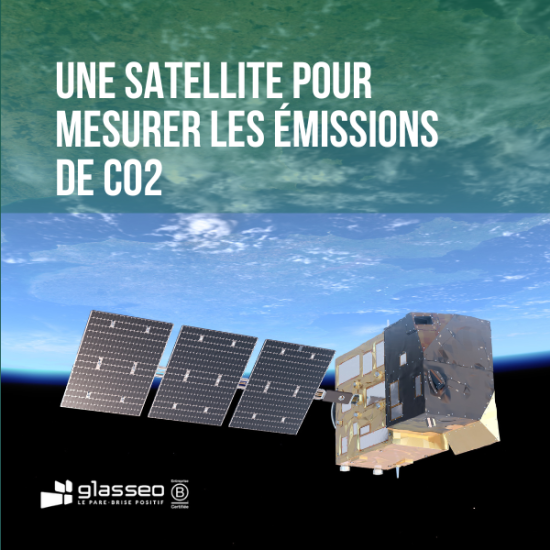
Le CO₂ ne fait pas de bruit, ne sent rien, ne se voit pas. Pourtant, il grimpe. En 2024, la concentration moyenne dans l’atmosphère a atteint environ 422,5 ppm, soit 50 % de plus qu’avant l’ère industrielle.
En parallèle, les émissions liées à l’énergie continuent d’augmenter. Elles ont atteint 37,8 milliards de tonnes de CO₂ en 2024, un nouveau record malgré le développement des énergies renouvelables.
Bref, on sait que ça chauffe… mais jusqu’ici, une grande partie des chiffres reposait sur ce que les pays déclaraient eux-mêmes.
Un satellite pour regarder la réalité en face
Pour sortir de ce flou, l’Europe a misé sur une nouvelle génération de satellites climatiques, développés notamment avec Thales Alenia Space. Leur mission : observer directement, depuis l’orbite, le CO₂ émis par l’activité humaine.
Deux grands projets se complètent.
MicroCarb, piloté par le CNES, cartographie les sources et puits de CO₂ à l’échelle de la planète : là où le gaz est émis et là où il est absorbé par les océans et les forêts. MicroCarb, lancé en juillet 2025, est déjà en orbite et commence à cartographier le CO₂ à l’échelle de la planète.
La mission CO2M (Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring) vise, elle, les émissions dues aux activités humaines : trafic, industrie, production d’énergie. Thales Alenia Space fournit les charges utiles des trois satellites qui mesureront très précisément ces émissions. Lancement prévu en 2027.
Ces satellites ne sont pas là “pour faire joli” dans le ciel. Ils ont un rôle clair : donner à l’Europe un outil indépendant pour savoir ce qui se passe vraiment, et pas seulement ce qui est écrit dans les rapports officiels.
Passer du déclaratif au constaté : la vraie révolution
Jusqu’à présent, chaque État publiait ses émissions à partir de ses propres calculs : consommation de carburant, chiffres de l’industrie, statistiques nationales. C’est précieux, mais cela reste déclaratif.
Avec MicroCarb et CO2M, on change de dimension. On garde les inventaires nationaux, mais on les compare à des mesures issues de l’espace. Les satellites fournissent des cartes du CO₂ atmosphérique au-dessus des pays, des grandes villes et des zones industrielles. Si les déclarations et les observations ne collent pas, la différence devient visible.
On passe donc d’un système basé sur la confiance et les tableurs à un système où l’on peut constater. En clair : moins de “on pense que”, plus de “on voit que”. Pour le climat, c’est un changement de jeu.
Pourquoi GLASSEO regarde aussi vers l’espace
On pourrait se dire : quel rapport entre un satellite ultra high-tech et un technicien qui remplace un pare-brise sur un parking ?
Chez GLASSEO, on essaye de réduire notre impact avec des leviers très terre-à-terre : flotte d’utilitaires électriques, optimisation des tournées, éco-conduite, recyclage des pare-brise, sensibilisation aux modes de vie plus sobres. Chaque choix s’appuie sur des données concrètes : kilomètres parcourus, consommation, temps de trajet, nombre de pare-brise recyclés. lire notre programme pare-brise positif
Les satellites climatiques font la même chose, mais à l’échelle de la planète. Ils transforment les promesses en courbes, les discours en cartes d’émissions. Ils sont, en quelque sorte, le “compteur général” de notre effort collectif.
Pour une entreprise engagée dans la décarbonation, c’est rassurant et exigeant à la fois : nos actions locales s’inscrivent dans une image globale qui devient visible, chiffrée, vérifiable.
Un tableau de bord planétaire pour les entreprises engagées
Avec ces nouvelles données, les États pourront vérifier si leurs politiques fonctionnent vraiment. Mais les entreprises auront aussi un contexte beaucoup plus précis.
Quand une grande métropole décide de réduire le trafic, le satellite voit si le CO₂ baisse au-dessus de la zone. Quand une région mise sur le train plutôt que sur la voiture, l’effet finit par se lire dans l’atmosphère.
Moins de blabla, plus de données vérifiées
Avec ces satellites, il devient plus difficile de se cacher derrière des moyennes nationales ou des belles plaquettes. Les politiques publiques pourront être corrigées en fonction de ce qui est observé, pas seulement de ce qui est annoncé.
Les ONG, les chercheurs, les citoyens disposeront d’une base de données indépendante pour suivre les trajectoires des pays et des grands émetteurs. Les accusations de greenwashing ne reposeront plus seulement sur des intuitions, mais sur des cartes et des séries temporelles.
En résumé : le satellite ne décide de rien, mais il enlève une excuse. Quand on sait précisément ce qu’on émet, continuer comme avant devient beaucoup plus difficile à justifier.
Et nous, dans tout ça ?
Un satellite ne va pas fermer une usine à charbon ni choisir à notre place entre avion et train. Mais il change notre rapport au réel.
Quand GLASSEO choisit d’acheter des utilitaires électriques plutôt que thermiques, c’est une décision locale. Quand d’autres entreprises font le même choix, que des villes repensent leurs mobilités et que des particuliers réduisent leurs trajets, l’effet finit par se voir… au sens littéral, dans l’atmosphère.
C’est ça, le passage du déclaratif au constaté : on ne parle plus seulement d’intentions, on mesure des résultats. Les satellites ne sauveront pas la planète à eux seuls. Mais ils nous fournissent un miroir honnête.
À nous de faire en sorte que, vu d’en haut, la courbe s’inverse enfin. Et que les choix du quotidien y compris celui de réparer plutôt que de remplacer son pare-brise deviennent visibles.